Depuis le début des années 90, Sheep On Drugs nous a offert une grande série de tubes parfaits pour faire la fête, malgré le fait que la chance n’ait pas toujours été avec eux, comme vous pourrez le lire. Après huit ans sans enregistrer, ils sont de retour avec une nouvelle chanteuse, Does Dark Matter et meurent d’envie de nous faire partager leur musique. On a parlé avec Fraser, qui jouera à Madrid avec Sheep On Drugs au DarkMad, qui aura lieu à Madrid le 15 et le 16 octobre.
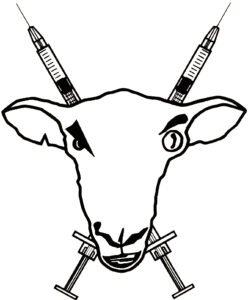 —Dans une interview, tu mentionnais que le nom du groupe avait à voir avec le fait de se faire sa propre idée sur les drogues. Comment ton opinion sur la consommation des drogues a-t-elle évolué au fil des ans ? C’est un sujet récurrent dans ta musique.
—Dans une interview, tu mentionnais que le nom du groupe avait à voir avec le fait de se faire sa propre idée sur les drogues. Comment ton opinion sur la consommation des drogues a-t-elle évolué au fil des ans ? C’est un sujet récurrent dans ta musique.
—Les drogues ont été un sujet récurrent dans ma vie, d’où ma musique. Je n’ai jamais vraiment eu d’opinion sur la consommation de drogues des autres. En ce qui concerne la mienne, j’ai décidé que tout allait bien, avec modération (même si la liste des drogues que je consommais a diminué au fil des ans). En fait, je suis en assez bonne santé ces jours-ci. Je suis passé du statut de toxicomane à celui de consommateur de drogue responsable.
—Que peux-tu nous dire des débuts de Sheep on Drugs ? Comment as-tu rencontré Duncan X et commencé à faire de la musique ?
—J’ai rencontré Duncan pour la première fois en 1988, lorsque j’ai emménagé dans la même maison que lui à New Cross, à Londres. J’avais récemment acheté des instruments électroniques après avoir décidé que je ne voulais plus travailler avec d’autres musiciens (qui ne se présentaient pas aux répets ou qui étaient trop saouls pour jouer correctement), car j’avais jamais eu de bonnes expériences. Duncan n’était pas musicien, il était pas mal physiquement et avait de bonnes idées en général. On était tous les deux dans l’étrangeté surréaliste et l’expansion de l’esprit. On aimait l’acid house, mais on était déçus qu’aucun groupe ne joue de cette nouvelle musique électronique. On a donc décidé de créer le nôtre. C’est comme ça que Sheep On Drugs est né.
—Alors, quelles étaient tes influences à l’époque ? Principalement acid ?
—L’acid house, pour l’utilisation de machines pour composer de la musique, mais punk pour l’attitude, rock pour les guitares et musique tribale pour les sons d’animaux et l’exotisme.
—Comment était la scène rave anglaise du début des années 90 ? Ça devait être du genre dément.
—À l’époque, elle me semblait assez monotone. Une partie de la musique était bien, mais les gens étaient tous des automates consommateurs de « E » (MDMA), adorant les lasers. Ils faisaient tous la même chose, comme des moutons. C’est ainsi que nous avons eu l’idée du nom.
—Penses-tu que ce sentiment d’agressivité et en même temps de plaisir qu’on peut entendre dans ta musique a disparu dans la scène électronique avec les années ? De nos jours, tout le monde semble se prendre trop au sérieux.
—En effet. Sheep On Drugs était, et est toujours « ironique ». Toute l’idée de rock et de pop stars/idoles est ridicule. Nous sommes une parodie de ce ridicule.
 —Pourquoi avoir appelé votre premier album Greatest Hits ? Est-ce parce que vous avez inclus certains de vos singles ou était-ce juste pour déconner ?
—Pourquoi avoir appelé votre premier album Greatest Hits ? Est-ce parce que vous avez inclus certains de vos singles ou était-ce juste pour déconner ?
—En appelant notre premier album Greatest Hits, on comptait passer dans la section « Greatest Hit » du disquaire, on sous-entendait qu’on avait déjà du succès. C’était pas le cas, mais on pensait que ça aurait dû.
—Que s’est-il passé avec votre deuxième album ? Le style change, on perd cette sensation d’empressement présente dans le premier. Peut-être que les influences dub le font ressembler à un album de comedown alors que le premier est plutôt un album dansant.
—Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de dub sur …On Drugs, mais par contre on pourrait le qualifier de deuxième album difficile. On a toute sa vie pour écrire le premier album et environ 2 ans pour écrire le second. Malheureusement, Island Records n’a pas voulu qu’on bosse avec Gareth Jones à la prod, alors qu’il avait produit Greatest Hits, ce qui aurait contribué à la continuité de « l’album dansant ».
Au lieu de ça, lors de l’écriture de notre deuxième album, Island Records nous a donné aucun conseil. Livrés à nous-mêmes, on a eu l’idée de faire un album conceptuel. On l’a donc appelé On Drugs, ce qui donnait « Sheep On Drugs… On Drugs ». C’était aussi le deuxième album expérimental. On a expérimenté, à la fois chimiquement et musicalement, sans aucune contribution d’Island. À ce stade, notre rêve autrefois parfait avait été brisé en travaillant pour un grand label. Un exemple (entre autres) briseur de rêve : le label envoyait des côtelettes d’agneau en plastique avec nos disques promotionnels ! C’était d’un ringard. Quelle erreur ! Et on peut pas dire que c’était bon marché non plus. On a réalisé à ce moment-là qu’on était que de simples marionnettes entre leurs mains, qu’on ne contrôlait rien, pas même la façon dont on dépensait notre fric. Peut-être qu’une partie de notre mécontentement a été enregistrée sur cet album. Je pense toujours que c’est un bon album, mais qu’il n’a pas connu le succès qu’il méritait. Il y a de très bons morceaux dessus. « Slim Jim », « Slap Happy » et « Slow Suicide » sont des classiques. Melody Maker a rédigé un article de deux pages dessus, et l’a qualifié « d’album de la semaine ». La fête n’était donc pas tout à fait terminée. Ça a été le cas dès qu’on a commencé à bosser avec Invisible Records.
—Après cet album, tu as commencé à collaborer avec Martin Atkins. Comment l’as-tu rencontré ? Tu avais bossé avec lui dans certains de ses projets : Pigface, Rx et The Damage Manual.
—En gros, Polygram a acheté Island Records. Tout groupe qui devait de l’argent (des avances) à la maison de disques a été viré, ça en représentait un bon nombre. On venait de rentrer dans le top 40 britannique avec « From A To H And Back Again », donc c’était débile de vouloir nous virer aussi. On a pas eu le sentiment d’avoir eu toute la gloire qu’on méritait, du coup, on a créé le label « Drug Squad », pour continuer. Après ça, on a rencontré Martin Atkins. Je crois que Duncan a fait sa connaissance lors d’un concert à Londres et il nous a proposé un contrat. Un truc malhonnête, bien évidemment, et on l’a signé. Travailler avec était facile, tant qu’il aime ce que tu fais et que tu sais qui est le patron (c’est à dire, lui). Il se fait toujours passer pour ton pote, de manière très convaincante, mais faut pas se laisser tromper par les apparences.
 —Maintenant que tu en parles, que s’est-il passé avec le label Drug Squad ? Tu n’as sorti que quelques singles, non ?
—Maintenant que tu en parles, que s’est-il passé avec le label Drug Squad ? Tu n’as sorti que quelques singles, non ?
—On a créé notre propre label à la fin de notre collaboration avec le grand label. Avec le recul, penser que Duncan et moi pouvions diriger une maison de disques était une erreur. On a perdu beaucoup de pognon, on n’était pas très bons dans ce domaine. On a réussi à sortir 2 E.P., Suck et Strapped for Cash. Ces 2 EP ont été combinés pour créer Double Trouble, notre première sortie sur Invisible Records.
—Penses-tu que faire partie d’Invisible Records, avec le recul, était un point positif pour le groupe ?
—Non. C’est à cause de ça que Duncan a arrêté la musique. Martin Atkins et son directeur ont tenté de faire chanter Duncan pour qu’il signe un nouveau contrat alors qu’on était en tournée en 1998. Duncan n’a pas signé (brave homme) et n’a donc pas été payé. Il pouvait donc pas payer son loyer (ce qui était une condition préalable pour qu’il fasse la tournée de 6 semaines). Lui et sa femme enceinte étaient sur le point de se retrouver sans abri, dans la rue. Il n’a jamais pardonné à Invisible Records.
 —Dans One For The Money, on remarque une forte influence de la drum n’bass. Quand t’es-tu intéressé à ce style et t’intéresse-t-il toujours ?
—Dans One For The Money, on remarque une forte influence de la drum n’bass. Quand t’es-tu intéressé à ce style et t’intéresse-t-il toujours ?
—J’écoutais la radio pirate DnB au milieu des années 90, je me suis dit que c’était vraiment une musique psyché. Elle m’a vraiment attiré, alors j’ai commencé à l’intégrer dans le son de SOD pour l’album One For The Money. L’un de mes morceaux préférés sur cet album est notre reprise DnB de la chanson de la Velvet Underground, « Waiting For The Man ».
—Continuons de parler de la Drum n’ bass, l’un de tes projets parallèles s’appelle Bagman, et tu as sorti deux albums Wrap et Trax. Que peux-tu nous dire à leur sujet ?
—Quand Duncan a quitté SOD, je ne pensais pas pouvoir continuer avec le groupe, alors j’ai lancé Bagman. C’était un projet solo de DnB. C’était rafraîchissant de travailler seul sans enregistrer de voix pendant un moment. Cela n’a duré que quelques albums car je voulais recommencer SOD avec un autre chanteur. Je sentais que SOD avait un nom dont je pourrais peut-être attirer plus d’argent que Bagman, qui était (et est peut-être toujours) très underground. À ce moment-là, je ne savais pas que très vite, vendre de la musique ne rapporterait plus d’argent à personne.
—En 1997, le groupe a sorti un album de remix, intitulé Never Mind The Methadone. Dans l’album, il y a un remix de Teho Teardo, un musicien expérimental italien : Comment as-tu eu l’idée de l’inclure dans l’album ?
—C’était une idée de Martin Atkins. Teho Teardo avait sans doute bossé pour lui bien avant ça, il a donc été engagé pour faire un remix de notre morceau.
—Dans cet album, on retrouve une chanson avec Pigface, tu faisais partie du groupe, non ? Quels souvenirs as-tu de cette expérience ?
—Je n’ai jamais fait officiellement partie de Pigface bien que je sois monté sur scène avec eux à quelques reprises. Le morceau de l’album était une reprise de « Back In Black » par AC/DC. Encore une idée de Martin Atkins, qui pensait qu’on devait l’enregistrer juste avant de partir en tournée. On a enregistré la musique et le chant, Martin l’a fait mixer dans son studio pendant que nous étions en tournée.
—Grace Jones a fait une reprise du groupe. Sa musique t’intéressait ? Tu l’as rencontrée, non ?
—J’adore Grace Jones et j’ai été étonné qu’elle veuille faire une reprise de « Track X », qu’elle a rebaptisée « Sex Drive ». Je suppose que le fait que Chris Blackwell nous ait fait signer chez Island Records a aidé. Ma seule déception a été que Sly et Robbie n’ont pas joué sur sa reprise. Nous l’avons rencontrée. J’ai reçu un appel dans le studio de répétition du New Jersey. Le directeur de la tournée m’a passé le téléphone et m’a dit que c’était Grace Jones ! On a bavardé pendant quelques minutes et on a organisé une rencontre ce soir-là dans son appartement à Manhattan. J’y suis allé avec Duncan et notre ingé son. On y est restés toute la nuit, on s’est bien amusés, puis on est partis le lendemain matin pour commencer notre tournée aux États-Unis.
—Et la question incontournable sur Duncan. Comment va-t-il ? Il a arrêté la musique pour commencer à travailler comme tatoueur. L’un de tes tatouages est-il son œuvre ?
—Duncan va bien, je le vois presque toutes les semaines. C’est un tatoueur très respecté. Il a fait la plupart de mes tatouages.
 —Dans Fuck, tu es devenu le chanteur principal du groupe. Qu’as-tu ressenti ?
—Dans Fuck, tu es devenu le chanteur principal du groupe. Qu’as-tu ressenti ?
—L’album ne s’appelle pas Fuck, t’as l’esprit mal tourné. Il s’appelle F ** K. Cela pourrait être FUCK ou FUNK ou FORK… Quand je me suis retrouvé sous le feu des projos, j’ai compris ce que Duncan devait certainement ressentir. C’est beaucoup plus difficile d’être leader, mais j’ai réussi à m’en sortir. Pour certains morceaux, je suis toujours chanteur. C’est une sensation formidable d’avoir le public dans la paume de ta main.
—Tu as rencontré Johnny en 2006. D’après toi, comment a-t-elle contribué au son du groupe ?
—Elle a beaucoup d’énergie, joue très bien du clavier et a une belle voix. Une voix féminine, un truc que je ne pourrai jamais avoir. C’est aussi une excellente parolière.
—Dans Medication Time, une chanson est intitulée « War on Drugs ». Curieusement, je regarde Narcos Mexico ces jours-ci. Tu penses que la légalisation pourrait être une solution ou bien quelque chose de négatif ?
—La « guerre contre la drogue » ne fonctionne pas, mais je ne sais pas si la légalisation des drogues est la solution. Imagine un peu de l’héroïne de marque légale sur les rayons des supermarchés, annoncée à la télévision. Il y aurait beaucoup de nouveaux toxicomanes et beaucoup de nouvelles overdoses et de décès. La décriminalisation est peut-être la voie à suivre ?
—Qu’as-tu fait pendant l’intervalle de neuf ans où tu n’as rien publié ? J’ai lu que tu remixais d’autres artistes, tu peux nous en dire plus ?
—Pas tout à fait 9 ans, mais certainement 8. On a sorti Club Meds en 2011 puis Does Dark Matter en 2019. Pour être honnête, j’ai été déçu par l’industrie de la musique. Depuis que Napster a commencé le partage de fichiers en 1998, l’industrie a diminué. Les gens, par conséquent, ont commencé à insister pour que la musique soit gratuite. Ces jours-ci, l’industrie du disque soutient une poignée d’artistes, tous de pop super commerciale. Les gens écoutent généralement de la musique sur Spotify ces jours-ci, souvent sur la version gratuite. Alors, où est l’argent ? Comment les musiciens sont-ils payés ? Les redevances de streaming sont si pitoyablement petites qu’elles sont une vaste blague. C’est pourquoi le vinyle et les cassettes reviennent. Les musiciens peuvent joindre leur musique gratuite à ces formats et vendre l’objet physique. C’est la seule façon pour eux de gagner de l’argent grâce à la vente de musique. Sinon, dès que la musique numérique est publiée, elle est téléversée sur YouTube et distribuée gratuitement.
 —Comment s’est passé l’enregistrement de Does Dark Matter, après ces huit ans sans sortir de nouvelle chanson ?
—Comment s’est passé l’enregistrement de Does Dark Matter, après ces huit ans sans sortir de nouvelle chanson ?
—C’était un enregistrement vraiment inspirant et édifiant. J’adore toujours autant me retrouver en studio et j’ai hâte qu’ils rouvrent. On a un autre album à moitié terminé, prête à être enregistré.
—J’ai lu sur ta page Facebook que le groupe est en train de faire un roman graphique sur Sheep On Drugs. Tu peux nous en dire plus ?
—Je l’ai appelé un « roman graphique », mais ce sera plutôt un livre illustré de nouvelles. Des histoires des archives de Sheep On Drugs. J’ai commencé certaines des illustrations et écrit en gros certaines des histoires. Ça va me prendre un certain temps pour le terminer, mais je pense pouvoir y arriver.
—Que penses-tu de l’industrie musicale anglaise en ce moment ?
—Quelle industrie musicale anglaise ? Elle est si petite désormais qu’elle ne soutient qu’une poignée d’artistes ultra commerciaux. Je n’en aime aucun. Il ne semble plus y avoir beaucoup de place/d’argent pour les artistes de musique alternative. C’est vraiment dommage, je n’ai jamais vraiment aimé la pop ultra-commerciale et c’est on dirait bien que c’est tout ce que l’industrie propose. J’ai toujours préféré la musique « underground », « alternative ». Malheureusement, l’industrie de la musique anglaise n’est plus assez lucrative pour financer de tels groupes. Les labels « Indie » qui signaient ces groupes (comme SOD) n’existent plus.
—Comment as-tu vécu cette pandémie ? Je suppose que tu as également annulé certains concerts. Au moins tu as sorti un single, non ?
—Cette pandémie est un cauchemar. Plus vite elle sera terminée, mieux ce sera. On a sorti un single cet été, principalement pour rappeler aux gens qu’on existe toujours. On a également réalisé une vidéo pour presque toutes les pistes de notre dernier album Does Dark Matter, pour que les gens n’oublient pas qu’on est toujours capables de jouer. Il nous en reste une à faire. Tout ça, c’est de la promo pour pouvoir organiser des concerts quand ce sera de nouveau possible.
—Que pouvons-nous attendre de Sheep on Drugs dans un proche avenir ?
—On a un nouvel album à moitié terminé. J’espère le finir l’année prochaine au plus tard, une fois que les studios rouvriront. Il y a de très bons morceaux dessus. J’ai hâte de commencer à le mixer.
—Que peut-on attendre de ton concert au DarkMad ?
—Il sera fantastique. On a tellement envie d’être à nouveau adorés sur scène… On vous promet que vous ne serez pas déçus.




